Inventaire des cercles (extrait) : Cinquième et sixième cercles
Cinquième
et sixième cercles
D’abord, j’ai regardé longtemps la mer, pour être
sûr qu’elle tourne bien à l’endroit, qu’elle ne reparte pas en arrière, et je
me suis dit, ces flots, ils ont l’air de rouler droit, ils vont me faire
arriver. La mer les pousse doucement de l’autre côté, juste par petits
mouvements et me voilà arrivé. Si la mer ne m’emmène pas, qui
m’emmènera ? J’imagine ça comme
se faire bercer, se laisser porter par le vent levant. C’est une question
d’équilibre. Elle déversera de l’autre côté, en un roulis léger, ce qu’elle a
charrié patiemment, sur une plage de sable blanc aux senteurs de monoï. Je
roulerai alors gentiment, mouillé, au pied d’une de ces serviettes de plage
colorées.
Et puis, j’ai
regardé encore longtemps la mer et je me dis que l’eau est molle, qu’elle ne
nous portera pas, pas moi en tout cas, qu’elle ne se montrera pas assez solide
pour moi, pour porter mon poids, mes affaires, mon urgence, ma détresse.
Pourtant, je ne lui demande pas de faire des détours mais d’aller juste tout
droit, au plus près en face, là où mon regard se cogne chaque jour, sur ce
désir calcaire, ce roc grand et imposant. Patient malgré les incursions de la
mer, il reste là en position et c’est lui qui montre le chemin. La mer
saura-t-elle le reconnaître ? Sûrement, car sa beauté ne peut pas décevoir.
Alors, quand j’ai embarqué j’ai fait de ce
bateau ma maison. Ma maison-bateau. C’est à la fois un point de repère et un
esquif fragile ballotté par la marée de l’Océan Atlantique, par le ressac des
eaux grises de la Manche, par les vagues transparentes de la Mer Méditerranée,
par celles de la Mer Adriatique, par
les eaux bleues de la Mer d'Alboran, par celles de la Mer des Baléares, par les flots du Golfe de
Corinthe, par
ceux de la Mer de Crète, par ceux de la Mer Égée, par la marée du Golfe de Gabès, par celle
du Détroit de Gibraltar, par celle de la Mer
Ionienne, par les vagues du Bassin Levantin, par celles de la Mer de Libye, par celles de la Mer Ligure, par le ressac du Golfe du Lion, par celui de la Mer de Myrto, par celui de la Mer de Sardaigne, par celui de la Mer de
Sicile, par les flots du Canal de Sicile, par ceux du Golfe Saronique, par ceux
du Golfe de Syrte, par les vagues du Golfe Thermaïque, par celles de la Mer de Thrace et par celles de la Mer Tyrrhénienne.
Me voilà à bord. Et
je sens la clarté de l’eau s’éloigner. On ne m’a pas tout dit, pas le passeur
en tout cas. Pourtant tout se déroule avec une grande simplicité. Il y a eu des
rumeurs de tempête, de lutte, mais les vents ont balayé tout cela. Il n’en est
rien. La mer est restée plate, à peine quelques clapotis. Pas de signal
d’alerte. Pas de MAYDAY. Pas de message aux garde-côtes. Juste un naufrage pur
et simple, sûrement intentionnel. Et c’est là que je vois cette embarcation
pourrie, vieille, disloquée et fendue, rapiécée et usée qui n’a de cesse de
prendre l’eau et qui coule et coule à l’infini. L’éclat calcaire du rocher dans
ma pupille cesse alors de briller et je retourne lentement à mon obscurité, le
corps détrempé. Quand on coule, tout est question de poids, puisque tout corps plongé dans un liquide reçoit une poussée, qui
s'exerce de bas en haut, et qui est égale au poids du volume de liquide
déplacé. Alors je joue au bouchon, la tête hors de l’eau, je monte,
flotte, pousse et je descends, coule, sombre. Jusqu’à ce que tout devienne
immobile, comme dans tout lieu éternel. Pourtant j’aperçois encore ce fil noir
et je sais que je n’ai pas encore passé la ligne d’horizon. Je le fixe
intensément et je m’aperçois qu’il n’est pas noir en réalité, qu’un halo jaune
l’entoure et qu’il est moucheté de petits points verts comme de minuscules
palmiers disposés le long d’une plage de sable. Je pense alors que l’eau ne m’a
pas encore tué, qu’elle me laisse filer comme dans un rêve. Et je n’ai de cesse
de me cogner à cette ligne qui accroche tant mon regard.
Des bouts, voilà ce
qu’il reste. De nous, des bateaux. Eux aussi, comme nous, ils ne coulent que
quand ils ne leur restent qu’un seul bout de bois. Des bouts au milieu des sacs
en plastique qui flottent, des papiers déteints, des lunettes de soleil, des
faux passeports, des jeans élimés et des baskets sans lacet, des bouts sur
lesquels des coquillages marins ont élu domicile sans perdre de temps, en s’y
incrustant. En faisant de nous leur terre d’adoption, ces mollusques parasites
nous donne alors, étrange paradoxe, la possibilité de les accueillir.
 |
| Nikolaj BS Larsen, Ode to the Perished, 2011 |
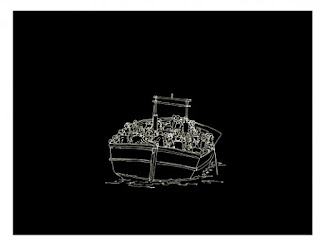

Commentaires